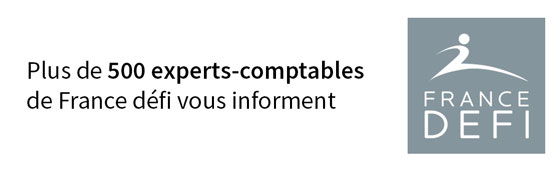Les avis d’inaptitude sont en hausse : la médecine du travail en a prononcé 138 176 en 2023, soit 3 801 de plus qu’en 2022, d’après les derniers chiffres disponibles. Pour le cabinet Voltaire avocats, qui a mené en juillet un séminaire en ligne sur ce sujet, ce phénomène s’explique à la fois par une judiciarisation accrue des relations de travail, une forte hausse des troubles psychosociaux dans le contexte post-Covid ainsi qu’une instrumentalisation croissante de la médecine du travail par les employeurs et les salariés.
Ne pas confondre inaptitude et invalidité
L’inaptitude, qui peut être de nature professionnelle ou non professionnelle, n’est pourtant pas un dispositif parmi d’autres pour rompre le contrat de travail. « Elle est prononcée par le médecin du travail lors d’une visite médicale et ne doit pas être confondue avec l’invalidité, qui est prononcée par la Sécurité sociale », rappelle Valérie Surrault, responsable de l’équipe juridique social au cabinet Michel Creuzot, membre de France Défi. S’il y a généralement un échange avec l’employeur en amont de l’avis, le médecin du travail est le seul à pouvoir établir que l’état de santé physique ou mental du salarié est incompatible avec le poste qu’il occupe.
Une fois le salarié déclaré inapte, l’entreprise dispose d’un mois pour trouver une issue, soit le reclassement, soit le licenciement. « L’employeur n’est pas obligé de payer son salarié pendant cette période », souligne Valérie Surrault. L’avis d’inaptitude peut comporter deux mentions qui ont un impact sur la suite de la procédure : la première stipule que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et la seconde que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». « À partir du moment où le médecin coche l’une de ces deux cases, l’employeur est exonéré de recherche de reclassement », indique l’experte.
Procédure de droit commun
Si aucune de ces deux mentions n’est retenue, l’employeur doit entreprendre une recherche de reclassement, au cours de laquelle il doit consulter son CSE (s’il y en a un). Cette étape est relativement simple dans une petite entreprise comptant peu de postes de travail mais peut devenir compliquée si l’entreprise est plus grande. C’est d’ailleurs sur cet aspect de la procédure qu’il y a le plus de contentieux. « Si aucun poste n’est trouvé, l’employeur doit informer par écrit le salarié des motifs qui s’opposent à son reclassement, précise Valérie Surrault. Nous conseillons de faire cette démarche même si l’employeur est exonéré de reclassement par le médecin du travail. »
Si le reclassement ou le licenciement n’a pas abouti dans le mois suivant la prononciation de l’inaptitude, l’entreprise doit reprendre le versement du salaire.
En cas d’impossibilité de reclassement, la seule solution est de procéder au licenciement du salarié. C’est la procédure de droit commun qui s’applique, avec des spécificités concernant les indemnités. « Si le reclassement ou le licenciement n’a pas abouti dans le mois suivant la prononciation de l’inaptitude, l’entreprise doit reprendre le versement du salaire », prévient Valérie Surrault. L’indemnité de licenciement, à laquelle a le droit tout salarié ayant au moins huit mois d’ancienneté, correspond à la plus avantageuse entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle.
La prévention, un atout clé
Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, l’indemnité légale de licenciement est doublée et s’avère généralement plus avantageuse que l’indemnité conventionnelle. À cela s’ajoute une indemnité compensatrice de préavis, qui ne s’applique pas dans le cas d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle. Si la Sécurité sociale reconnaît a posteriori le caractère professionnel de l’inaptitude, l’employeur doit régulariser les sommes dues à son ancien salarié. Ces ajustements peuvent représenter une charge financière significative pour de petites entreprises, d’où l’importance de prévenir les risques en matière de santé et de sécurité au travail.