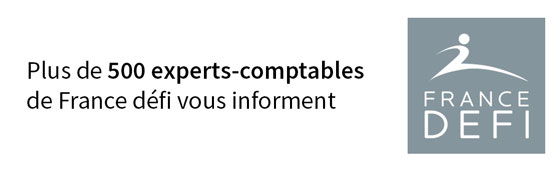Une décision récente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) étend la protection contre les discriminations indirectes aux salariés parents d’un enfant handicapé.
Concilier vie professionnelle et responsabilités familiales peut être particulièrement ardu lorsque l’on est parent d’un enfant en situation de handicap. Si de plus en plus d’entreprises se mobilisent pour soutenir les salariés aidants, tenir davantage compte des contraintes auxquels ils font face apparaît aujourd’hui comme une obligation. Dans une décision du 11 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi estimé que refuser d’aménager les conditions de travail d’une salariée mère d’un enfant handicapé pour lui permettre d’assurer les soins à ce dernier pouvait constituer une forme de discrimination.
Elle se prononçait sur le cas d’une salariée italienne, opératrice de gare, qui avait demandé à être affecté à un poste à horaires fixes le matin afin de pouvoir prodiguer à son enfant lourdement handicapé les soins dont ils avaient besoin à heure fixe. L’employeur lui avait refusé cette affectation.
Discriminations directes et indirectes
Transposée en droit français, la directive 2000/78/CE en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail proscrit depuis 2000 les discriminations notamment liées au handicap, qu’elles soient directes ou indirectes, au sein du monde du travail dans l’Union européenne. Pour rappel, les discriminations directes sont des différences de traitement délibérées fondées sur un des critères interdits par la loi comme le sexe ou le handicap par exemple. « La discrimination est indirecte lorsqu’une disposition, un critère, une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un effet défavorable pour une personne ou un groupe de personnes en raison d’un critère prohibé par la loi », précise le défenseur des droits. La question qui était ici posée à la CJUE était de savoir si la discrimination indirecte pouvait être retenue même si la victime n’était pas elle-même porteuse de handicap.
Discrimination par association
La CJUE estime que oui. « L’interdiction de discrimination indirecte fondée sur le handicap s’applique à un employé qui n’est pas lui-même handicapé mais qui fait l’objet d’une telle discrimination en raison de l’assistance qu’il apporte à son enfant atteint d’un handicap lui permettant de recevoir l’essentiel des soins que nécessite son état », précise-t-elle. Elle s’appuie pour cela sur la notion de discrimination « par association », déjà consacrée par sa jurisprudence pour les discriminations directes. En 2008, l’arrêt Coleman avait ainsi étendu la protection contre les discriminations directes aux salariés n’étant pas eux-mêmes en situation de handicap mais qui feraient l’objet d’un traitement défavorable en raison de l’aide apportée à leur enfant en situation de handicap.
« Aménagements raisonnables »
De l’interdiction de discriminations indirectes par association fondées sur le handicap découle, selon la CUEJ, l’obligation pour l’employeur de procéder à des « aménagements raisonnables » des conditions de travail du ou de la salarié(e) concerné(e). Il peut s’agir de réduire le temps de travail ou d’affecter le collaborateur à un autre poste. La CJUE précise cependant que ces aménagements doivent être adoptés pourvu qu’ils « n’imposent pas à cet employeur une charge disproportionnée ». Autrement dit, il faut tenir compte des moyens et de la situation financière de l’entreprise, seuls à même de justifier un refus d’aménagement pour qu’il ne soit pas considéré comme discriminatoire.
En France, plusieurs dispositifs, notamment des congés spécifiques, peuvent être mobilisés par les salariés aidants. Désormais, ils disposent d’un argument supplémentaire pour négocier leurs conditions de travail, la décision de la CJUE s’imposant aux juridictions françaises.