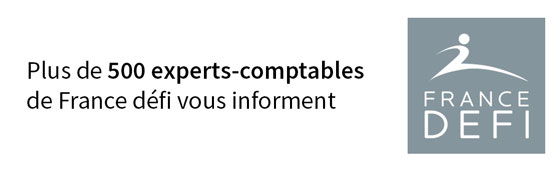Prendre conscience des différences et de leur impact sur les situations de travail peut aider à faire d’une équipe multiculturelle une véritable richesse. C’est le point de vue de Catou Faust, professeure à EM Lyon business school et spécialiste de ce sujet.
Travailler avec des collègues à l’autre bout du monde n’est aujourd’hui plus l’apanage des dirigeants de grandes multinationales. Si cette situation n’a rien d’extraordinaire, elle n’est toutefois pas anodine. « Les équipes interculturelles sont plutôt moins performantes que les équipes homogènes », pointe Catou Faust, spécialiste du management interculturel, consciente de briser là une sorte de mythe. « Cela peut bien sûr être une source de richesse importante, avec parfois 25 % de performance en plus mais seulement à condition de mettre certaines choses en place », tempère-t-elle.
Des malentendus culturels
Les différentes cultures imprègnent les comportements et perceptions au travail, ce qui peut être source de malentendus. Elles peuvent induire des rapports différents à la hiérarchie, au temps, à la manière dont on accorde sa confiance – sur la base d’un titre, d’une expérience ou d’une interconnaissance et d’éléments affectifs –, et une approche différente de la communication. Quand certains valorisent une posture plutôt assertive ou le fait d’être volubile, l’expression d’émotions, d’autres seront plutôt dans l’économie de mots. Même les objectifs et le déroulé d’une réunion, respectueuse de l’ordre du jour et décisive ou plus flexible et pensée comme un moment d’échange des idées par exemple, peuvent varier selon les cultures.
À ces sources d’incompréhension s’ajoutent souvent la question de la distance physique entre les membres de l’équipe et du projet, et la barrière de la langue. Si l’anglais s’impose souvent, ce choix n’est pas neutre. « Cela crée des biais et peut générer un stress et une réserve pour ceux dont ce n’est pas la langue natale dans l’équipe », illustre Catou Faust qui invite à s’appuyer sur le modèle Split théorisé par l’Américaine Tsedal Neeley pour comprendre les différentes dimensions à intégrer dans un contexte de management interculturel.
Réduire les distances de tout ordre
Le S se réfère à la structure du pouvoir : selon la proximité des membres de l’équipe avec le manager ou le siège de l’entreprise, le nombre de personnes dans l’un ou l’autre des pays, les salariés peuvent se sentir plus ou moins satellisés. « Pour la réussite de l’équipe, le rôle du manager est primordial dans la réduction de cet écart de perception de soi comme important ou pas », insiste la spécialiste.
Le P désigne les process. Le recueil systématique de l’avis de tous, la création d’espace de « small talk » pour réduire la distance sociale entre les membres de l’équipe, le fait d’instaurer des feedbacks ou de doubler certains messages pour expliciter ce qui parfois relève de l’implicite peut ainsi aider. Le L renvoie à la langue et aux biais qu’elle implique.
Reconnaître les différences
Le I de Split représente l’identité. « Il vaut mieux parler des cultures, reconnaître à chacun sa différence, sans stéréotyper, plutôt que de considérer que ce n’est pas une question », explique Catou Faust, qui note la nécessité de faire exister aussi l’identité de l’équipe en tant que telle. Le T enfin renvoie à la technologie : choisir d’organiser une visioconférence pour une communication synchrone n’aura pas les mêmes effets que de privilégier l’échange de mails, permettant à chacun d’exprimer ses idées par écrit.
« La culture d’entreprise est importante. Même dans un environnement monoculturel, elle peut être plus ou moins inclusive, ouverte au fait de challenger la manière dont se font les choses », poursuit la professeure. Le choix des personnes recrutées pour manager ces équipes est aussi décisif. « Il faut que le manager ait une appétence pour la différence et qu’il ait la capacité d’analyser les situations avec du recul, en se demandant quels biais ont pu jouer, en ayant conscience des siens aussi », explique-t-elle. La mise en place de formations dédiées peut en cela s’avérer incontournable et, dans tous les cas, accélérer la prise de conscience de ses particularités et du rôle joué par la culture dans les interactions de travail.